Construire le son d'un film, un jardinage en mouvement

Une journée de l'AFSI et LMA avec Daniel Deshays.
Le compte rendu écrit est d'Axel Zapenfeld.
En partenariat avec l'association LMA, l'Afsi a organisé le samedi 26 mai dernier une nouvelle rencontre avec D. Deshays.
Le titre de cette rencontre était : Un jardinage du mouvant.
La métaphore du jardinage.
"Toute construction sonore cinématographique est conçue à partir de l’image. C’est une longue tradition qui trouve sa source à l’arrivée du cinéma sonore. Le muet a établit les règles : l’image sera première dans l’ordre de la construction.
En s’ajoutant à l’image le son confirme ce qui est vu.
Associés, sons et images fusionnent. Ils produisent un unique effet de réel qui fait disparaître la représentation produite séparément par chacun. Les plans se succèdent mais chacun ne représente qu’un unique espace mêlant visuel et sonore. Là, tout son importé qui appartient au hors champ semble relever du même espace que les images, même s’il a été rapporté d’un tout autre lieu. Si tout son resynchronisé draine avec lui le lieu dont il est issu, ce lieu étranger va muer sous la puissance de l’image pour sembler appartenir au monde unique défini par elle. Rompre le synchronisme c’est faire éclater l’homogénéité reconstruite de l’espace audiovisuel unique. Les espaces visuels et sonores séparés se mettent alors à exister séparément. La désynchronisation est le lieu de co-existence des espaces et des temps dans un même plan.
Dans son œuvre Film-Socialisme Jean-Luc Godard nous mène plus loin, il propose une reconstruction multiphonique non centrée des sons. Rompant avec la « monodie » sonore du cinéma, il nous place face à une diversité co-existante : un différentiel surgissant qui semble rétablir un dissensus sonore, comme échafaudé sur le dissensus démocratique. Face à une parole un bruit ou une musique, conçus pour arriver ensemble, associés dans un même espace de représentation, il nous place face à une diversité synchronique dissociée, sortant séparément dans chaque haut-parleur. Elle fait éclater d’un coup cette idée de l’unité sonore assemblée dans un même espace homogène qui semblait si bien établie ; là c’est toute l’histoire de la représentation sonore cinématographique qui bascule.
L’idée de la coexistence autonome des sons et des images invite à penser d’autres modalités d’échafaudage de l’œuvre. Le son peut être pensé et construit dès le début, avant l’image. Tenter de construire à partir du son serait mettre en œuvre de nouvelles hypothèses.
La métaphore du jardinage, outil de construction, aiderait ainsi à garder du recul sur l’ensemble de la démarche. Interrogeant le morcellement des tâches elle permettrait d’unir les démarches simultanées dans une conscience de globalité. Coexister n’est pas fusionner. Le jardin, zone de réunion de la diversité des espèces permet à chacune d’évoluer dans un temps qui lui est spécifique. Multiplier et éclaircir. La patience est de mise. L’éclaircissement est nécessaire. Comme les plants, les sons aussi multiples soient-ils, entre surgissement et disparition, ne peuvent être considérés qu’un à un."
D. Deshays.
1ère partie : LA MATINÉE
Écouter la conférence du matin divisée en 3 parties :
L'intervention fut riche mais des thèmes se détachèrent, qui constituent nos trois parties. Daniel évoqua d'abord la nécessité d'envisager le son à l'image comme une forme indépendante, qui appelait une écriture. Il cita quelques exemples d'oeuvres travaillant cette notion en profondeur, comme le film Paysage, de Sergei Loznitsa, India Song, de Duras, le cinéma de Tarkovski, de Cavalier ou celui de Tati. Il incita, pour mieux prendre conscience des pouvoirs de cette forme, à revenir à un travail d'écoute, pour constituer une histoire plus spécifiquement sonore. Bien qu'il ne soit par nature qu'une résonance, le son ne peut pas se fabriquer que comme une simple conséquence de ce qui se passe à l'image.
Daniel fit ensuite un salutaire éloge de l'économie sonore, en évoquant d'abord le cas de Robert Bresson. L'organisme du spectateur est fait pour choisir, exclure des éléments de sa perception, pour ne pas se voir saturer par la profusion du monde qui l'entoure. Le cinéma doit prendre cela en compte, d'autant plus que ses effets n'apparaissent vraiment que dans la rupture, le surgissement. Il s'épanouit dans l'espace laissé au désir plutôt qu'à un remplissage, à un trop-plein.
Assumer le côté sensuel du son, entrer dans un corps à corps, de l'ordre du toucher, retrouver le geste initial, voilà une stratégie de travail possible. C'est aussi le thème qui introduisit une première séance d'échange avec le public de l'atelier. Ces notions subtiles, "infra-minces", ont pour mission, au fond, de faire garder à l'esprit que le son doit toujours restituer du vivant.
PAUSE DÉJEUNER

LMA s'est occupée de la nourriture, et l'AFSI des boissons

2ème partie : L'APRÈS-MIDI
Suite à un problème technique, nous n'avons pas pu diffuser en stéréo ou 5.1 dans la salle durant cette journée.
Daniel nous présente 7 extraits de films, fiction ou documentaire, puis nous en parle.
Vous allez continuer à écouter Daniel et les bandes son des films diffusés. J'ai choisi de garder les extraits "sonores" des films projetés pour donner une idée des films présentés. Nous ne pouvons pas vous présenter ici les extraits des film en vidéo.
De plus le son a un fort pouvoir sur l'imaginaire, et comme le dit Daniel dans la première partie, c'est aussi passionnant d'écouter la bande son d'un film sans l'image.
Enfin ça vous donnera peut-être l'envie d'aller voir ou revoir ces films.
Herman Slobbe : l'enfant aveugle 2, de Johan Van Der Keuken (1966)
Dans ce court-métrage de 29 minutes, le cinéaste néerlandais se propose de centrer son récit sur un adolescent aveugle, lui déléguant en quelques sortes la responsabilité de la sonorisation du film. Il place le spectateur à l'endroit de la sensation du personnage, dans un exercice d'empathie et de liberté.
Big Ben/Ben Webster in Europe, de Johan Van Der Keuken (1967)
Présent sur le même DVD que le précédent, cet autre court-métrage, autour du jazzman Ben Webster, creuse encore un peu plus les potentialité d'autonomie du son et de l'image, dans une création pleine d'ingéniosité.

( un problème technique empêche momentanément d'écouter cet extrait ).
Stalker, d'Andreï Tarkovsky (1979)
Daniel se servit du film de Tarkovski pour illustrer les dérives parfois désastreuses des édition DVD et plus généralement, de la re-mastérisation. Faites sans tenir compte des intentions artistiques des cinéastes, ces copies commerciales témoignent parfois du manque de crédit créatif attribué au travail sonore. C'est un défaut encore plus criant pour une oeuvre aussi inventive sur ce plan que celle de Tarkovski. Les extraits du 5.1 "illégitime" et le mono original sont à écouter.
Film Socialisme, de Jean-Luc Godard (2010)
Le dernier grand film épave de Godard, à voir ou revoir comme un fascinant creuset d'inventions formelles, de cet homme dont le l'âge n'a pas érodé l'intensité artistique et la radicalité. Daniel nous présente ses expérimentions autour du sous-titrage, contre la fatalité du centrage auquel pourrait condamner le 5.1, et pour une idée de la saturation, utilisée en toute conscience. Entre autres...
Les ensortilèges de James Ensor, de Nora Philippe et Arnaud de Mezamat (2010)
En présence dans la salle de la monteuse, Daniel proposa un extrait de ce film présentant l'oeuvre du peintre belge. L'occasion pour lui de nous parler, avec des mots édifiants et touchants, de sa collaboration avec la compositrice Marie-Jeanne Séréro, et de rendre hommage à un montage qui laisse toute sa place à une stratégie de tension et de résolution, ou d'irrésolution.
L'Ordre, de Jean-Daniel Pollet (1974)
Cet essai cinématographique, sur une léproserie en Grèce, traite magnifiquement de l'indifférence et de la compassion, et joue pour cela avec un son détaché, souvent autonome.
Le Rêve de São Paulo, de Jean-Pierre Duret et Andrea Santana (2005)
Ce film sur la migration vers la grande ville de millions de paysans brésiliens du Nordeste accompagne la grande traversée et les rêves de José, 18 ans. L'exercice est, là encore, de trouver la juste place, au plus près de cet être vivant.
Conclusion :
Toutes les photos ont été prises avec un téléphone portable.

Merci à toutes les personnes qui ont pris sur leur temps pour aider à l'organisation, la préparation, le repas et le rangement :
- à Marine Multier et Jérôme de la Fémis pour l'accueil.
- à Anita Perez, Jean-Pierre Bloc, Tadhée bertrand et Marc Daquin de LMA pour la co-organisation.
- à Vincent Goujon et Yves Coméliau pour l'aide logistique.
- à Elisha Albert pour la diffusion Son et l'enregistrement de cette journée.
- à Tapages pour le matériel technique Son pour la diffusion et l'enregistrement.
Rencontre avec Pierre Lenoir.
AFSI, le 17 octobre 2011.Projection de deux extraits en 35 mm SRD:Le Crime est notre affaire...
Interview de Frédéric Dubois
Interview de Frédéric Dubois
Au sein de sa salle de montage, entouré d'écrans et de...

Rencontre AFSI avec Bernard Chaumeil : Foi de hiéroglyphe !
C'est comme un trésor que l'on redécouvre : samedi 2 février 2013 après-midi, en hommage à son...
Rencontre avec Nadine Muse, monteuse son
Plusieurs fois nommée pour le César du meilleur son, Nadine Muse est une monteuse son reconnue...

Sennheiser a invité les membres de l'AFSI à un petit déjeuner
Le 13 Novembre,une bonne dizaine d'ingénieurs du Son membres de l'Afsi étaient les invités de...
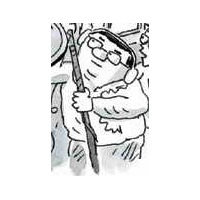
Les artisans du X3
L’AFC a convié 3 membres AFSI à venir rencontrer l’équipe au travail d’Aaton Digital.Nous avons...




